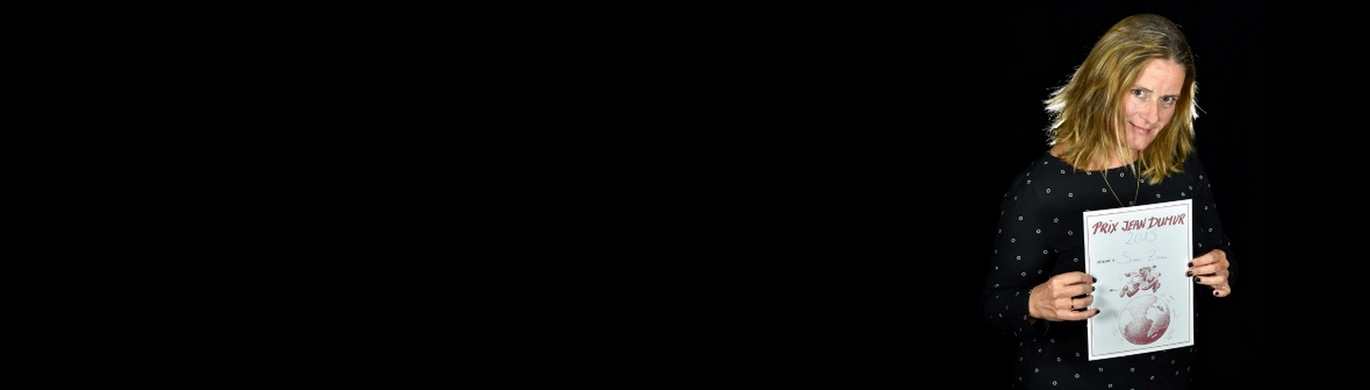Chère Sonia,
Cet été, tu nous as offert un moment de cinéma que je ne suis pas prête d’oublier. Et qui, j’espère, restera dans la mémoire du journalisme.
C’était sur les ondes de La Première de la radio suisse romande, le premier épisode de ta série d’été « Eclats de Méditerranée. » Et ce moment était un moment de silence.
On était à Lampedusa, un grand bateau de la guardia costiera chargé de réfugiés était en train d’accoster. Tu te tenais au milieu des garde-côtes, des équipes sanitaires, des bénévoles et des policiers, et depuis là, tu chuchotais à peine, quelques rares mots épars, dans ton micro, pour nous permettre de goûter à la qualité unique de cette scène, à priori pas très radiophonique, puisqu’elle était faite – de regards -et de silence. Les réfugiés regardent les gens sur la berge, les gens sur la berge regardent les réfugiés et il n’y a pas un bruit.
C’était à la radio et pourtant je l’ai vu, ce bateau, glisser sans un bruit jusqu’au débarcadère, et les exilés sourire d’être arrivés sains et saufs -parce que ce qu’on appelle la crise des migrants, ce n’est pas seulement des noyades et du malheur. Tu nous a donné à voir tout cela sans webcam et sans appareil photo : c’est la magie de la radio, quand elle est faite avec talent.
C’est aussi, dans le cas de ton travail, quelque chose de plus que le simple talent d’évocation. C’est le résultat d’une interrogation et d’une quête constantes sur le sens de ce métier de témoin que nous faisons, et sur la manière de le pratiquer.
Que faisais-tu à Lampedusa ? Non, tu ne t’es pas précipitée avec tout le monde parce que soudain, à la fin de l’été, quatre ans après le début de la guerre en Syrie, « la crise des migrants » est soudain devenue le sujet qui a chassé tous les autres de la une.
Tu y es allée au printemps, pour concrétiser un projet mûri encore avant, durant l’hiver. Il y avait déjà eu des morts en Méditerranée même si on n’en parlait pas beaucoup. Tu as senti monter le danger que cette Grande Bleue que tu aimes tant ne devienne une nouvelle frontière –un danger qui s’est douloureusement accentué avec les événements du week-end dernier à Paris.
Et tu as décidé de partir, pour raconter non pas les noyades et les drames, mais pour tenter d’appréhender cet espace commun de circulation et d’échanges, pour te mettre en quête de son héritage essentiel, de ce qui fait qu’au-delà de la diversité des 20 pays qui bordent cette mer, quelque chose en elle nous rassemble, nous, chrétiens, musulmans, noirs et blancs.
C’est ce que tu as fait. Tu t’es posée, à Lampedusa mais aussi à Marseille ou à Cassis (tu n’avais pas le budget pour faire le tour de la Grande Bleue, mais grâce à tes interlocuteurs, tu as évoqué aussi le Liban, la Grèce, la Kabylie, la Turquie). Tu t’es longuement entretenue avec des pêcheurs, des chercheurs, des écrivains, des banlieusards, des curés. Tu nous as parlé d’histoire, de géologie, de biologie.
Et aussi, tu nous as parlé de la vraie vie et des joies de la pêche et de la baignade, parce que dans la vraie vie, on n’arrête pas de se baigner sous prétexte qu’un peu plus loin, des gens se noient. Parce que « l’actualité » et la vraie vie ne sont pas des mondes séparés, mais entremêlés. Mine de rien, tu as aussi replacé, grâce à quelques fines analyses de certains de tes interlocuteurs, la « crise des migrants » dans le contexte de la militarisation croissante de la Méditerranée.
Tu nous as fait sentir, aimer et réfléchir. Au bout du compte, tu nous as fait prendre la mesure de ce que nous risquons de perdre si notre mer, Mare Nostrum, devient effectivement une nouvelle frontière.
C’est ce qui s’appelle une mise en perspective. Tu nous as donné les moyens d’être moins bêtes, moins ignorants, face aux nouvelles brutes, et brutales, qui nous parviennent quotidiennement sur le sujet qu’on appelle « la crise des migrants ».
Cette histoire de frontières, de séparations, de pourquoi un jour on vit ensemble et le lendemain on s’entretue, ça te travaille, c’est le moins qu’on puisse dire. Le fait d’être née de mère vaudoise et de père moitié croate moitié slovène, né en Serbie, y est pour quelque chose, bien sûr.
Mais il y a aussi cette passion, cette gourmandise que tu as pour les êtres humains et ce talent singulier qui est le tien pour les faire parler. Devant ton micro, on les entend s’ouvrir comme des fleurs. Ce n’est pas de leur intimité que tu es curieuse, mais de la pâte hétéroclyte dont ils sont faits en tant qu’humains, des élans clair-obscurs qui les animent. Le nationalisme est ta préoccupation première et sous-jacente, mais elle passe, à hauteur d’humain, par une quête constante des ressorts du vivre-ensemble.
Je t’ai côtoyée au Nouveau Quotidien. Tu étais encore simple stagiaire et, mine de rien, tu as fait la « une » du premier numéro du journal comme envoyée spéciale à Zagreb, pour raconter la guerre qui commençait.
On est en 1991. Quelques jours plus tard, tu signes l’éditorial et par la suite, tu continues à « couvrir » la guerre, comme on dit, avec une qualité de regard qui a fait les belles heures des débuts du Nouveau Quotidien. Il y avait des articles, mais aussi des chroniques, plus tard rassemblées dans le livre « Déchirements yougoslaves ». Déjà, tu y faisais un pas de côté pour raconter les choses autrement.
J’y reviendrai. Mais d’abord il faut dire comment tu étais arrivée au Nouveau Quotidien. Etudes en sciences po, mâtinées d’anthropologie à Lausanne. Ce que tu aimes, c’est découvrir des mondes et essayer de les comprendre. Tu commences, après une licence brillamment obtenue, par six mois de voyage en Asie et en Océanie et par un long séjour en Nouvelle Calédonie, à partager la vie d’une tribu kanak. Un oncle pasteur t’avait conseillé la charmante petite île d’Uvéa. Il t’avait dit : tu verras, c’est très calme. Sauf qu’on était en 1988. Le temps que tu arrives, les affrontements entre indépendantistes et gendarmes français ont fait 22 morts. L’actualité commençe déjà à te poursuivre.
Tu t’es immergée dans, et passionnée pour, cette île-monde d’Uvéa, cette société pauvre mais abondante, cette vie si différente. Tu as même failli rester en Nouvelle Calédonie : Tes amis kanaks t’ont dit : « Si tu veux faire une thèse sur nous, on te donne une case ». Apparemment, comme tous tes interlocuteurs par la suite, ils étaient déjà enchantés par ta qualité d’écoute.
Mais tu es rentrée à Lausanne. Où tu as effectivement songé à te lancer dans une thèse. L’autre sujet auquel tu pensais, à part les Kanaks, c’était « le nationalisme en Yougoslavie ». Parce que tu as de sacrées antennes, Sonia, et que tu le sentais venir, le problème. Mais ton prof n’avait pas ton intuition et il a proféré cette phrase historique : « Le nationalisme n’est pas un sujet d’avenir. »
De toutes façons, en te documentant sur tes sujets d’intérêt, tu t’étais rendu compte que les meilleurs livres étaient écrits par des journalistes. Tu avais envie de raconter des histoires, de parler des gens, bref, de faire toutes ces choses très peu académiques qui font de toi un auteur perdu pour la science.
Le journalisme, donc, et c’est tant mieux pour lui. Après quelques piges à 24 Heures, Construire, L’Hebdo, l’aventure naissante du Nouveau Quotidien. Premier sujet : le nationalisme en Yougoslavie. Ton premier édito disait, en un tout petit peu moins de signes, ce qu’aurait dit ta thèse: deux nationalismes s’affrontent, ça va faire mal, et ils iront jusqu’au bout. Je suis sûre que ton prof lit le journal et qu’il t’a lue avec intérêt.
Le journalisme donc. Mais lequel ? Tu es, chère Sonia, une des personnes les plus exigeantes, et donc les plus intranquilles que je connaisse. Pas exactement le genre qui fait ses heures en remplissant des cases existantes avec ce qu’il est désormais convenu d’appeler du « contenu ».
Tu ne cesses de t’interroger sur comment travailler et sur ton rapport, notre rapport, à « l’actualité ». Tu as une tendresse particulière pour les non-sujets. Ce qui tu aimes, ce sont ces petites choses parlantes, colorées et odorantes, qu’on raconte au bistrot quand on revient de voyage, qui disent la réalité tellement mieux que les grands événements, mais qui, invariablement, sautent au montage d’un article ou d’une émission.
C’est comme ça, d’ailleurs, que sont nées tes chroniques yougoslaves: tu revenais de reportage, on allait boire un café, on te disait : raconte ! Tu racontais et souvent tu disais: ça, c’est dommage, je n’ai pas pu le mettre dans l’article. Alors un jour, Jacques Pilet t’a dit : fais-nous des chroniques où tu racontes les choses comme tu nous les racontes.
Alors, après le Nouveau Quotidien, tu as continué à chercher dans cette direction, ta direction. Celle du récit, de l’évocation. Tu n’avais pas juste envie d’aller dans un autre journal. Tu m’as dit lorsque je suis venue te voir pour préparer cet hommage: « Il fallait que je sorte du journalisme si je voulais continuer à faire du journalisme. » Ca m’a frappé parce que ça rappelle la célèbre phrase du prince Salina dans « Le Guépard » : « Il faut que tout change pour que tout reste comme avant ». Et le nom de l’auteur du livre résonne avec une douceur particulière à tes oreilles, puisqu’il s’agit de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
La rencontre avec Frank Musy, à la radio, qui produisait à ce moment-là les « Carnets de route », a été déterminante. D’abord parce que tu découvrais ce nouveau langage, le langage radiophonique, dans lequel tu t’es épanouie et que tu portes à un degré de raffinement et de puissance rares. Mais aussi parce que Franck Musy t’a encouragée à t’engager, à oser la voix personnelle, à « faire du Sonia Zoran. » Attention : « faire du Sonia Zoran », ça n’a rien à voir avec le narcissisme, ou avec le repli sur des préoccupations personnelles. C’est une manière de dire « je » pour mieux dire « nous » et pour mieux donner à voir des réalités, qui, toujours, interrogent le collectif, le social, le politique.
Après les « carnets de route », sur La Première, ta quête t’a amenée à une belle série de séries construites sur des rencontres : Comme un soleil, Dans les bras du figuier, Cactus, ou encore le merveilleux Sur la route de Gümulschlük en 2013.
Avec Gümulschlück, on a encore voyagé, mais tu n’es pas toujours en vadrouille, Sonia. Tu n’as pas du tout besoin d’aller jusqu’en Turquie ou en Nouvelle Calédonie pour t’émerveiller de la diversité des êtres humains. Tu peux très bien rester en Suisse. Et là, tu fais quelque chose de rare dans le journalisme romand : tu t’intéresses, tu nous intéresses, à la masseuse thaïlandaise et à l’épicier turc. Ou mieux encore, si possible : à l’épicier kurde de mère turque et marié à une juive tunisienne, celui qui fait péter toutes les catégories. Tu donnes à voir la Suisse dans toute sa diversité culturelle et ethnique. Tu ne te lasses pas de célébrer la splendeur de son impureté ethnique.
Tout à l’heure, je disais : j’espère que ta série Eclats de Méditerranée restera dans les annales du journalisme. Mais le jour où on ira dans les archives de la RTS pour la retrouver, dans quelle case va-t-on la chercher ? Ce ne sera pas dans la case « Information ». Tes émissions sur la Première sont du ressort du département des programmes. Un département où tu es plus à l’aise, dis-tu, puisqu’on y trouve, pêle-mêle, des animateurs, des saltimbanques, des journalistes. Tu poses un problème aux archivistes, Sonia, parce que qu’on ne sait pas dans quelle case te mettre.
Pourtant, ce que tu fais, c’est bel et bien du journalisme. Du journalisme de caractère et d’approfondissement. Du journalisme de mise en perspective et de plus-value. Ces mots ont été tellement répétés n’est-ce pas ? On frise le syntagme figé. Ces dernières années, dans les débats et les interviews sur l’avenir de la presse, nous avons beaucoup entendu les responsables de publications expliquer que, dans le flux médiatique qui nous submerge, le journalisme ne survivra que s’il saura faire la différence par l’approfondissement, la mise en perspective, la plus-value, l’originalité.
En somme, Sonia, tu fais le journalisme de demain. Pourtant, pour le faire, tu es sortie de la case « information ». Comme journaliste, ça me donne à réfléchir. Un peu comme me donnent à réfléchir ces confrères qui, pour mieux dire la réalité, deviennent romanciers.
Tout à l’heure, le débat va porter sur le traitement journalistique de la crise des migrants. Le plus frappant, lorsqu’un sujet devient omniprésent parce que la machine s’est emballée, c’est l’effet d’assuéfaction : à force d’absorber chaque jour notre petite dose de drame avec le café du matin, on s’habitue, on s’immunise, on est mitridatisés. Parce que l’émotion, ça s’émousse, et c’est un peu comme s’il fallait à chaque fois augmenter la dose pour mobiliser l’attention.
Celle du dosage er de l’assuéfaction, c’est une question grave et complexe qui se pose aux rédactions. Pour bien faire, surtout dans ces moments de crise aigue, il faudrait se donner le temps et le recul pour réfléchir, pour discuter de la pertinence de tel reportage ou de tel cadrage. Il faudrait des rédactions où le journaliste rentre du terrain et on lui dit : « Raconte ! », au lieu de lui demander : « Tu veux combien ? ». Il faudrait soigner cet espace de partage et d’élaboration. C’est la question que m’inspire ton travail, Sonia. Je me demande : comment préserver cet espace, où est-ce qu’il existe encore ?
Ce qui est sûr, c’est qu’il faut aujourd’hui, peut-être plus que jamais, une bonne dose de courage, d’exigence intellectuelle et d’indépendance d’esprit pour pratiquer ce journalisme-là. Ce sont les valeurs que défend le prix des Amis de Jean Dumur. Et que le jury s’accorde à te reconnaître, pour la série de cet été mais aussi pour l’ensemble de ton parcours jusqu’ici.
Au nom du jury, permets-moi, chère Sonia, de te féliciter et de te dire toute notre admiration et notre impatience à découvrir les prochains épisodes de tes aventures professionnelles.
Anna Lietti